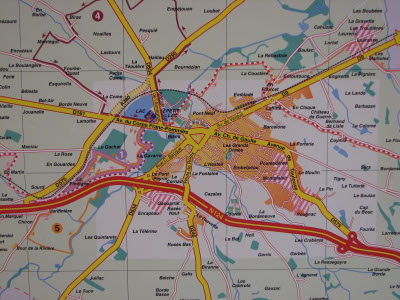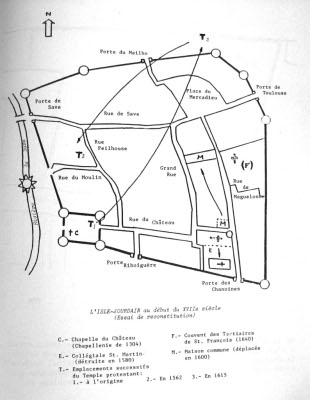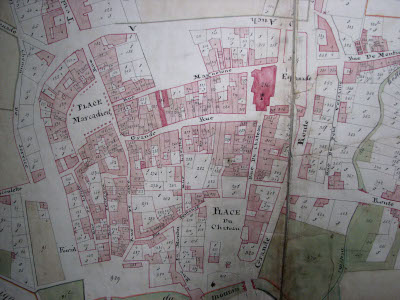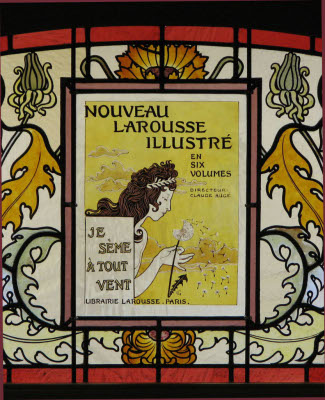Chef-lieu
de la seigneurie devenue comté au XIVe siècle, L'Isle-Jourdain
a reçu vers la fin du XIIe siècle des coutumes dont l'exemplaire
consulaire est encore conservé aux archives départementales
sous une reliure de bois (poustètes) aujourd'hui refaite. Elle
fut administrée successivement par des prud'hommes, remplacés
par treize consuls, réduits à sept puis à quatre
(1484). Elle appartenait au XVIIIe siècle à l'élection
de Lomagne et au diocèse de Toulouse.
Devenue
chef-lieu de district sous la Révolution, et aujourd'hui chef-lieu
de canton, diocèse d'Auch, la commune compte parmi ses maires
les plus récents qui se sont succédé, depuis le
XXe siècle, Emile Thoulouse, Jean Ningres, les Barthélémy
père et fils, Joseph Délieux, Marius Campistron, Michel
Ghirardi, Louis Aygobère et Alain Tourné.
La
ville dispose d'une gendarmerie depuis la Révolution. Cette gendarmerie,
autrefois à cheval (cinq hommes hébergés avec leurs
chevaux dans l'ancien couvent des Cordeliers), s'est déplacée
rue Lafayette pour loger actuellement en bordure de la ville au faubourg
de Toulouse. Enfin, elle est le siège d'une caserne de Pompiers
dont le corps couvre tout l'est du département : elle fait suite
au premier pompier placé sous contrat en 1718 en tant que charpentier
de la mairie. L'acte stipule en outre qu'il "sera obligé
en cas d'incendie lorsqu'il sera appelé de courre au feu pour
tâcher de l'éteindre". Beaucoup plus tard (1940) une
brigade est née et s'est développée à la
suite de l'incendie de La Gavarre. Elle occupe de nos jours la deuxième
place par ordre d'importance dans le département.
Une
anecdote pour terminer. Durant la bataille de Toulouse de 1814, des
anglais passèrent par la ville. Ils accompagnaient en particulier
un chariot qui transportait une partie de la paye des soldats. Ils firent
halte sous les couverts de la place Gambetta (appelée alors place
du Mercadieu), et tandis qu'ils s'étaient réfugiés
pendant un orage dans un estaminet proche, des individus pillèrent
le chariot. C'est là, dit-on, l'origine de certaines fortunes
lisloises dont on pouvait désigner les bénéficiaires
encore au siècle dernier...